Pendant de longues semaines, Muriel, 36 ans, s’est levée la nuit pour pleurer dans la salle de bains, le visage écrasé dans une serviette-éponge afin d’étouffer ses sanglots. « Je ne voulais pas peser sur mon mari, ni inquiéter ma petite fille de 7 ans, qui elle aussi a eu beaucoup de peine à la mort de son oncle », confie-t-elle. Muriel a perdu son frère aîné adoré il y a deux ans, dans un accident de voiture. Pendant huit mois, elle a pris sur elle pour ne pas se laisser envahir par le chagrin et, surtout, pour masquer aux autres sa douleur. Elle poursuit : « Peu de temps après le décès, mon chef de service, plein de bonne volonté, m’a dit : “N’hésitez pas à prendre quelques jours de congés, c’est très important de faire son deuil.” Là, j’ai senti le gouffre qui sépare ceux qui ont perdu un être cher des autres. Le chagrin ne se soigne pas comme une grippe, faire son deuil en dix jours, cela n’a pas de sens ! » Ce n’est pas un hasard si les mots « faire son deuil » sont mal vécus par la plupart des endeuillés. « C’est une expression ambivalente, observe Christophe Fauré auteur de Vivre le deuil au jour le jour (Albin Michel, 2004), et fondateur et animateur d’un site Internet remarquable : traverserledeuil.com, car, en même temps qu’elle reconnaît la perte, donc la douleur, elle invite à oublier. » Pour le psychiatre, « faire son deuil » impliquerait que l’on se débarrasse rapidement de son chagrin afin de ne plus encombrer les autres.
Cette formule « s’est substituée à l’expression de Freud : “Le travail du deuil”, rappelle la psychanalyste Marie Frédérique Bacqué, professeure de psychopathologie et présidente de la Société de thanatologie (mort-thanatologie-france.com), auteure du Deuil à vivre (Odile Jacob, 2000), remplacement lié, dans notre société, à la tentative permanente de refoulement. Dans notre culture de plaisir, de productivité et de contrôle, l’endeuillé, comme le malade, dérange, car il rappelle violemment ce que chacun voudrait oublier : la mort. » Or, pour revenir à la vie, « il faut aller à travers le chagrin, avancer dans son deuil et l’intégrer, affirme la psychanalyste. Cela demande dans un premier temps de lâcher le refus, la maîtrise, afin de pouvoir vivre ses émotions et la réalité de la perte ».
Entre la vie et la mort
Freud, dans son article « Deuil et mélancolie » (in Métapsychologie de Sigmund Freud – Gallimard, “Folio essais”, 1985), présente l’atténuation progressive de la douleur due à la perte d’un être cher comme l’aboutissement d’un long processus intérieur. Lequel peut être plus ou moins long et douloureux suivant le sujet. Selon lui, après le choc de la perte et les diverses émotions qui s’ensuivent ( toutes marquées par le manque d’intérêt pour le monde extérieur et par la perte de la capacité d’aimer et d’agir), le psychisme de l’endeuillé finit par se trouver comme à la croisée des chemins. Son moi va-t-il suivre le destin de « l’objet » perdu dans la mort, ou bien va-t-il rompre le lien en se réinvestissant dans la vie ?
Plus l’être disparu – mais il peut aussi s’agir d’un idéal politique ou d’une profession – nous constitue, plus sa disparition est vécue comme une atteinte vitale, et plus le fil qui nous relie à la vie est ténu. En témoigne Marie-Andrée, 46 ans, qui, il y a douze ans, a perdu son bébé de 3 mois : « Le jour de l’enterrement, j’ai senti physiquement que quelque chose était aspiré hors de mon ventre et le suivait dans la tombe. Pendant des mois, j’ai vécu comme un zombie, je n’étais plus dans la vie. » Tout le travail du deuil va alors consister à desceller son destin de celui du disparu, en élaborant un nouveau lien avec lui. « Traverser ce moment pour revenir à la vie n’est pas abandonner ou oublier l’être que l’on a perdu, explique Marie- Frédérique Bacqué. C’est lui donner une nouvelle place en soi, une place qui ne nous empêche plus de vivre, d’aimer et d’agir. »
Un cheminement qui prend du temps
La psychanalyste insiste sur la lenteur et sur la complexité de ce processus : « Le travail du deuil est incompressible, on ne peut ni l’accélérer ni sauter des étapes. Il ne connaît pas le temps, il a ses tours et ses détours, ses haltes, on ne peut que se rendre disponible pour ne pas entraver ses mouvements. » Se rendre disponible, c’est-à-dire vivre sans freins ce que l’on ressent. Baptiste, 32 ans, avait 17 ans lorsqu’il a perdu son père, « mort d’une crise cardiaque à 44 ans. C’était un bon vivant et un gros fumeur, je lui en ai voulu terriblement de ne pas avoir eu la force d’arrêter. Pendant des mois, comme pour me venger, et dans un accès d’autodestruction, j’ai fumé presque deux paquets de cigarettes par jour. Puis j’ai cessé d’un coup, ma colère était retombée, et le chagrin m’a envahi brutalement ».
Les spécialistes sont unanimes : chaque cas est singulier, chacun traverse le deuil à son rythme et à sa façon. « À certains moments, la personne se croit tirée d’affaire, puis elle rechute et panique de se sentir reprise par un chagrin intense. C’est normal, le cheminement n’est ni rationnel ni linéaire, rassure Christophe Fauré. Il faut du temps pour accepter, pour exprimer toute la palette de ses émotions, puis pour tisser un nouveau lien avec le disparu et enfin pour réinvestir sa vie. » Marie-Edmée Cornille est coordinatrice bénévole au sein de l’association “Vivre son deuil” d’Île-de-France, elle mène principalement des entretiens téléphoniques avec des personnes en deuil. « Outre le besoin de parler encore et encore de l’être que l’on constant depuis des années, c’est la fréquence de la question : “Suis-je normal ou suis-je dépressif ?” On se rend compte alors combien, en plus de leur douleur, les gens méconnaissent ce qu’est un deuil, les émotions qu’il fait jaillir, les comportements et les besoins qu’il induit. C’est pourquoi, outre l’écoute, notre rôle est aussi de donner des repères, de manière que la peur de l’anormalité ne vienne pas faire obstacle au travail intérieur. »
La force du lien et du soutien
Il arrive que ce travail soit ralenti ou bloqué. Christophe Fauré identifie deux sortes de freins. « Ils peuvent être extérieurs, comme la précarité matérielle, l’isolement social, la présence d’enfants en bas âge, ou encore la maladie ou l’épuisement nerveux. Ces freins peuvent également être intérieurs, comme c’est le cas pour des personnes ayant des antécédents anxio-dépressifs graves, peur de se montrer vulnérables ou de faire face à leurs émotions, mais aussi honte d’appeler au secours. » Quoi qu’il en soit, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide à un travailleur social, à une association, à des amis ou à un thérapeute. « Nous sommes là pour toutes ces demandes qui n’osent pas se faire, insiste Marie-Edmée Cornille. Pour pallier l’absence de l’entourage, pour éventuellement orienter vers un psy ou un service social, pour répondre à des questions autant que pour écouter sans juger. »
Marie-Frédérique Bacqué souligne l’importance du soutien de l’entourage. « Souvent, les proches, famille ou amis, sont dans la fuite de l’endeuillé parce qu’ils ne savent pas quoi dire, mais il n’y a pas grand-chose à dire en vérité, le plus beau des cadeaux qu’ils puissent lui faire est d’écouter. Et d’éviter les formules toutes faites ou les conseils de vie parce que, de toute façon, il ne les entend pas et, pire, il les vit comme le déni de sa douleur. » Aude, 38 ans, a perdu la grand-mère qui l’a élevée il y a trois ans, elle était âgée de 86 ans. « Croyant m’aider, mes amis me répétaient : “Elle a bien vécu, c’est un bel âge pour mourir.” Ils ne comprenaient pas que c’était toute mon enfance qui mourait avec elle et que son grand âge n’était pas une consolation pour moi. Seule ma meilleure amie a compris, elle m’a offert un grand flacon de l’eau de Cologne que portait ma grand-mère, accompagnée d’une lettre magnifique sur “la présence éternelle”. »
Accepter la réalité de la perte, aimer le disparu d’une façon nouvelle sans pour autant renoncer à la vie, c’est sans doute ce que Freud entendait par l’expression « tuer le mort en nous », non pas le disparu, mais cette part obscure de nous qu’il faut convaincre de dire oui à la vie.
Les cinq étapes du chagrin
Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), psychiatre et psychologue américaine, a travaillé toute sa vie sur l’accompagnement des mourants. L’une de ses découvertes majeures est d’avoir identifié et formalisé les cinq étapes du chagrin (five stages of grief) que traverse l’individu confronté à la perte d’un être cher ou à l’imminence de sa propre mort. On peut vivre ces étapes dans le désordre ou seulement certaines d’entre elles (par exemple la colère, la dépression et l’acceptation).
Le déni (denial) : ce n’est pas vrai, c’est impossible.
La colère (anger) : pourquoi lui (moi) ? C’est injuste !
Le marchandage (bargaining) : laissez-le (ou moi) vivre encore au moins un an, si je m’en sors (ou s’il s’en sort), je changerai tout dans ma vie.
La dépression (depression) : tout est perdu, rien n’a plus d’importance, je suis déjà mort.
L’acceptation (acceptance) : je comprends et accepte que c’est comme ça, je sens une forme d’apaisement en moi.

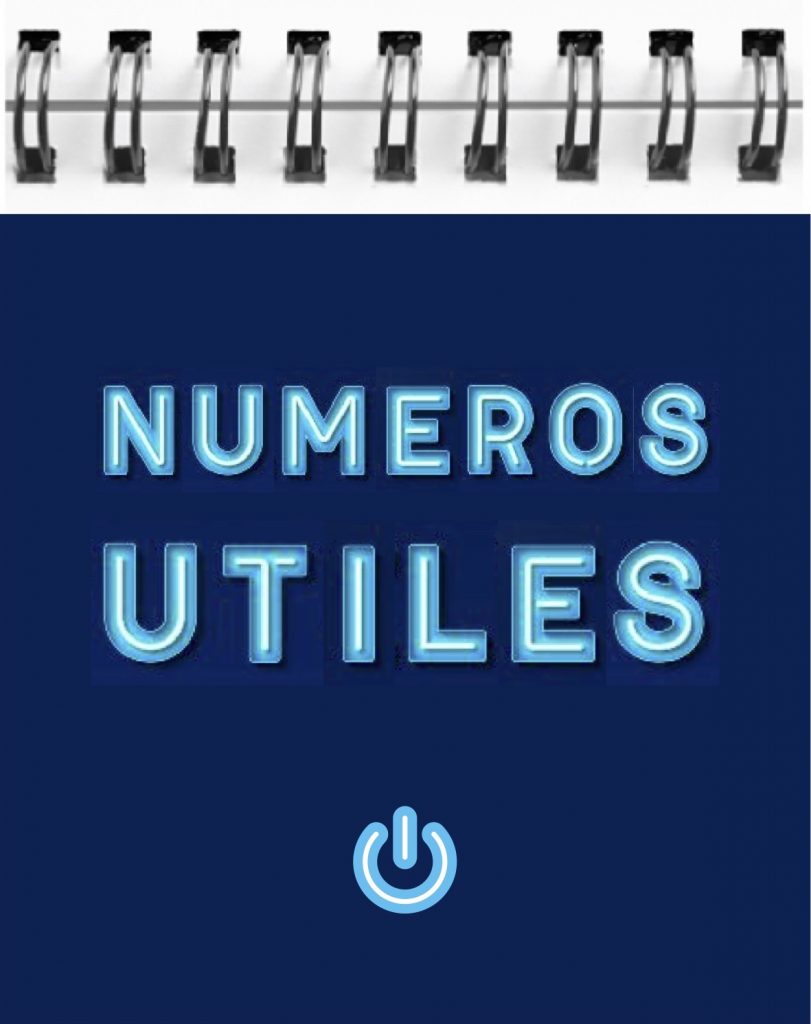


One comment on “Accepter le temps du deuil”
[…] Accepter le temps du deuil […]